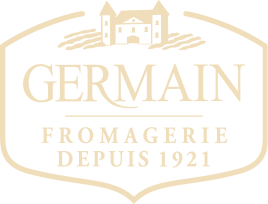Pourquoi parle-t-on de saison pour les fromages ?
Souvenez-vous des cours élémentaires : le cycle des saisons détermine un certain climat et l’état de la végétation. Résultat : ces facteurs naturels entrent directement en jeu dans la collecte et la qualité du lait, la fabrication du fromage, sa commercialisation et enfin sa consommation.
Zoom sur 3 déterminants naturels.
Parlons peu, parlons climat
Le climat et l’environnement naturel, tels que les minéraux que renferme le sol, ont une influence sur le cycle de développement des espèces végétales et le type de flore qui y pousse.
Le climat et ses variations au fil de l’année nous procurent l’herbe fraîche, le trèfle sauvage ou les fleurs de prairie. La nature offre aussi des périodes avec des herbes plus sèches, des feuillages moins denses et une végétation plus faible en azote.
Par conséquent, ce que mangent les animaux mis en pâture et qui produisent le lait, varient. Retenez ceci : pas la même qualité d’alimentation = pas la même qualité de lait. Logique !
On peut aussi résumer le facteur climatique et environnementale comme ceci :
À pâturage différent, goût différent. Petit exemple : en Corse, les brebis se nourrissent dans le maquis avec des herbes sèches. Elles produisent donc un lait acide et le fromager fabrique une Tomme avec plus de caractère. Merci mère nature !
Et qui dit climat, dit microclimat.
Microclimats pour maxi impact
Chaque région de France possède des particularités climatiques qui influencent directement la production fromagère. Ces microclimats, véritables signatures naturelles, déterminent non seulement la qualité du lait, mais aussi les techniques de fabrication et d’affinage.
Chaque fromage est un écosystème vivant où température, humidité et environnement local orchestrent une chorégraphie microbienne complexe. Les variations saisonnières créent des conditions uniques qui influencent directement la maturation et les caractéristiques organoleptiques. Découvrez-les sans plus attendre.
L’humidité : architecte des moisissures
En été, l’humidité élevée favorise le développement de :
- Penicillium candidum (croûte fleurie des camemberts),
- Géotrichum candidum (surfaces crémeuses).
En hiver, l’humidité plus faible modifie la croissance :
- Moins de développement des moisissures blanches,
- Croissance plus lente et plus irrégulière.
La température : conductrice bactérienne
Printemps : 10-15°C
- Prolifération des bactéries lactiques,
- Fermentation plus rapide,
- Développement de goûts plus vifs.
Été : 20-25°C
- Accélération des processus de maturation,
- Développement de bactéries plus agressives.
Hiver : 0-5°C
- Ralentissement bacterial,
- Affinage plus lent.
Ces multiples paramètres font de chaque fromage un produit unique, véritable empreinte d’un territoire et de ses saisons.
Il reste un déterminant naturel majeur : l’animal, sans qui nous ne fabriquerions aucun fromage.
L’animal et ses habitudes alimentaires
Vous l’avez bien compris : le rythme des saisons influence directement la production laitière et la qualité du lait, pierre angulaire de tout fromage. En effet, l’alimentation des vaches, brebis ou chèvres varie considérablement au fil de l’année : pâturages verdoyants au printemps, foin sec en hiver, ce qui se traduit par un lait moins riche, moins aromatique, moins gras et moins parfumé selon les périodes.
Au-delà de son alimentation, deux autres facteurs naturels entrent en ligne de compte dans la saisonnalité du fromage :
- En période de naissance, le lait tiré est alors destiné en priorité aux petits,
- La quantité de lait à disposition n’est pas illimitée. Les traites quotidiennes n’ont pas les mêmes rendement entre le matin et le soir.
💡Germain vous éclaire
Mais au fait, que mangent les vaches laitières ? On retrouve généralement la vache sur les pâturages de plaines riches, des vallées luxuriantes et des montages ensoleillés,
En hiver, les éleveurs laitiers mettent à l’abri leurs troupeaux et passent à une alimentation compactée, au foin et aux céréales. Un nouveau type de nourriture qui donne un lait aux apports différents.